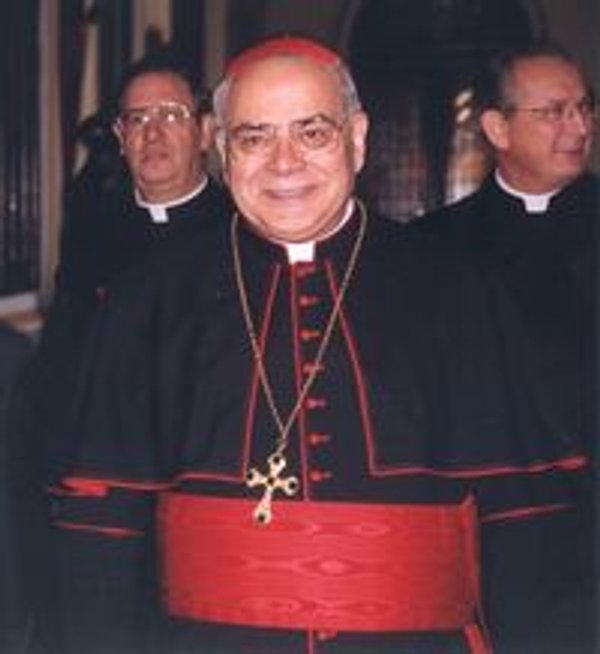Depuis que la Congrégation pour les Causes des Saints fut instituée en 1588 jusqu'à l'élection de Jean‑Paul II, les saints étaient 296 et les bienheureux 808. Tout au long de son pontificat, ce pape a canonisé 459 saints et a proclamé 1 274 bienheureux.
Pourquoi l'Église continue‑t‑elle à canoniser ?
La reconnaissance publique de la sainteté des martyrs et de ceux qui ont pratiqué les vertus de manière héroïque est une constante dans la vie de l'Église depuis les commencements. Dans sa lettre‑programme sur le millénaire que nous avons commencé, Jean‑Paul II fait référence avec un optimisme enraciné dans la foi, à la tâche pastorale passionnante qui attend l'Église en ce moment, et n'hésite pas à affirmer que la perspective devant laquelle doit se placer toute pastorale est l'appel de tous à la sainteté. Dans le cadre de cette perspective, le pape a voulu aussi donner un fort élan au nombre de canonisations et de béatifications tout au long de son pontificat. Avec la canonisation, l'Église rend grâces à Dieu, et en même temps elle honore ses enfants qui ont su répondre généreusement à la grâce divine et les propose comme intercesseurs et comme exemple de la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés.
Le symposium auquel vous participez à Séville aborde la figure de quelques chrétiens exemplaires du XXème siècle comme modèles pour les gens du XXIème siècle. Avez‑vous l'espérance que la vie et les œuvres d'hommes et de femmes comme eux peuvent changer ce monde en crise ?
Dieu seul conserve le monde dans son être, et sa volonté est que nous soyons tous saints et que la création entière s'achemine vers lui. Mais il veut compter sur nous, sur notre libre réponse. C'est chaque personne qui doit accomplir le projet de Dieu sur elle, qui est la sainteté, dans les circonstances concrètes où elle se trouve. Ce serait trop confortable et irréaliste d’attendre passivement un changement des structures. Mais, en même temps, la sainteté n'est pas une affaire purement individuelle, car l'Église est la famille de Dieu et c'est seulement comme membres de celle‑ci que nous atteindrons le but. Jésus‑Christ est la tête du Corps Mystique, dont font partie ceux qui sont déjà arrivés au Ciel ou se purifient pour y entrer ou sont encore des pèlerins sur cette terre. C'est dans cette merveilleuse communion des saints et communication de biens que devient réalité la sainteté de chacun. C'est dans ce cadre que se situent les bienfaits qui nous viennent de la fonction exemplaire et de l'intercession des saints. Vous me demandez si j'ai l'espérance. Bien entendu ! Nous venons de célébrer la Passion, Mort et Résurrection du Seigneur : là nous avons la réponse au découragement qui peut parfois se glisser en nous, en constatant le peu de qualité de notre réponse au vouloir de Dieu. Nous devons être persuadés que la grâce de Dieu est surabondante et surmonte de loin toutes les difficultés.
Pourquoi le procès de canonisation de Josémaria Escriva a‑t‑il été aussi rapide ?
La réforme de la procédure de canonisation introduite en 1983 par Jean‑Paul II a simplifié considérablement l'itinéraire des causes des saints. Les faits mettent en relief que plusieurs causes ont suivi un rythme notablement plus rapide que celle du fondateur de l'Opus Dei. Joséphine Bakhita, proclamée bienheureuse le même jour que Mgr Escriva, a été canonisée il y a deux ans. D'autres personnes béatifiées plus tard sont déjà canonisées comme sainte Maria Josefa del Corazón de Jesus et pour le 16 juin prochain est annoncée la canonisation du bienheureux Padre Pio.
Cette réforme de Jean‑Paul II correspondait au vœu exprimé par le concile Vatican II de voir sur les autels des saints contemporains, des personnes que tout chrétien considère plus proches des circonstances où évolue son existence, parce qu'ils ont vécu dans le même contexte culturel, avec des problèmes semblables à ceux que nous devons affronter chaque jour.
Cette année on célèbre le centenaire de la naissance de Josémaria Escriva. Son message, celui de l'appel à la sainteté des laïcs, est‑elle la grande révolution qu'attend l'Église catholique ?
Le bienheureux Escriva consacra toute sa vie à diffuser que tout chrétien doit sanctifier le travail professionnel, se sanctifier dans le travail professionnel et sanctifier les autres avec le travail professionnel ou dit autrement, « sanctifier la vie ordinaire, se sanctifier dans la vie ordinaire et sanctifier les autres avec la vie ordinaire ». L'harmonie est évidente entre ce message et le programme que Jean‑Paul II a proposé à toute l'Église, en entrant dans le troisième millénaire : « Et tout d’abord, je n'hésite pas à dire que la perspective dans laquelle doit se placer tout le cheminement pastoral est celle de la sainteté… Les voies de la sainteté sont multiples et adaptées à la vocation de chacun. Je remercie le Seigneur, qui m'a permis de béatifier et de canoniser ces dernières années de nombreux chrétiens, et parmi eux beaucoup de laïcs qui se sont sanctifiés dans les conditions les plus ordinaires de la vie. Il est temps de proposer à nouveau à tous, avec conviction, ce « haut degré » de la vie chrétienne ordinaire : toute la vie de la communauté ecclésiale et des familles chrétiennes doit mener dans cette direction » (Novo Millennio ineunte, n. 30‑31).
Ne finissent‑ils pas par devenir obsolètes les messages de beaucoup de saints qui ont vécu il y a des siècles, dans des circonstances très distinctes des nôtres ?
Je comprends que votre question fasse référence seulement à la vie des saints comme modèle pour notre conduite. Si tel est le cas, je vous réponds que seul Jésus‑Christ est le modèle. Les saints ne sont pas des modèles dans le sens propre, mais des copies ou des reproductions, plus ou moins parfaites, mais toujours incomplètes du modèle qu'est Jésus‑Christ. La sainteté est méta‑historique, en ce sens qu'elle est la même hier, aujourd'hui et toujours, car elle consiste à accomplir de façon achevée le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Et en même temps la sainteté est profondément incarnée et enracinée dans l'histoire. La vie des saints nous montre un exemple de comment l'identification avec le Christ est devenue une réalité dans des circonstances précises.