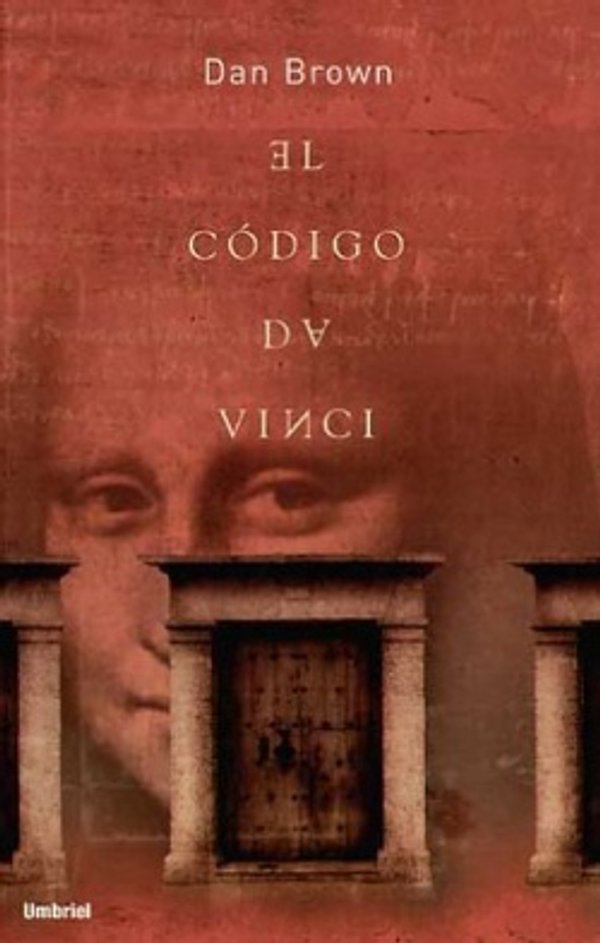Nicolas Weill voit dans ce succès commercial la confirmation du goût d’un certain public pour le mystère et le complot (« Le complot, ressort du “Da Vinci Code” ») : « En multipliant dans son récit les “effets de réel ” (par exemple l’utilisation dans une fiction de l’Opus Dei), en entretenant une certaine ambiguïté sur la véracité de tel ou tel détail, en poussant nombre de ses lecteurs à chercher “ ce qu’il peut y avoir de vrai ”, le texte peut être rattaché à une autre filiation que celle de la pure création littéraire : celle des mystifications qui, en dépit de leur fausseté reconnue ou dénoncée, continuent chez certains à être prises pour véridiques. » Nicolas Weill cite à ce propos le journaliste anticlérical Leo Taxil, qui, à la fin du XIXe siècle, prétendait dévoiler les pratiques “lucifériennes” des francs-maçons, et le fameux “Protocole des sages de Sion”, « libelle prétendant exhumer les documents secrets d’une prétendue conspiration juive visant à la conquête du monde », en fait une fabrication policière antisémite. « Bien sûr, le jeu avec le réel opéré par Da Vinci Code est moins nauséabond, puisqu’il se présente d’emblée comme un roman. Il n’en reste pas moins qu’il encourage et s’appuie sur le goût très contemporain de la “théorie du complot”, qui cherche à expliquer les grands événements par l’action occulte d’une secte aux ramifications internationales ».
Et de citer le philosophe Marcel Gauchet, « qui a soutenu la thèse paradoxale que la vogue du complot et des sociétés secrètes accompagne le mouvement même du “désenchantement du monde”. Cela parce que l’imaginaire de la conspiration avait pour corrélat que ceux qui y croyaient adhéraient implicitement à l’idée que l’histoire était faite par les hommes et non par la Providence. A terme, la stabilisation de la démocratie devait mettre un terme à ce genre de fantasme. »
Dans un autre article (« La légende noire de l’Opus Dei »), le chroniqueur religieux du Monde, Henri Tincq remarque : « Que Dan Brown ait puisé dans l’Opus Dei matière à intrigue n’a étonné aucun lecteur averti, ni aucun des membres d’une Œuvre lasse de prêter son nom aux stéréotypes les plus éculés. Depuis sa création en 1928 par un prêtre espagnol, José Maria Escriva, canonisé en 2002 par Jean Paul II, le filon de l’”Opus Dei-société-secrète” ne s’est jamais épuisé. L’organisation est pourtant présente dans les cinq continents (86 000 membres). Elle a la caution du pape, qui l’a érigée, en 1982, en “prélature personnelle” , un statut sur mesure mais prévu par le droit de l’Eglise. Malgré cela, l’Opus Dei vit et prospère, depuis soixante-dix ans, avec cette sulfureuse réputation. » Et l’auteur d’ajouter, en faisant allusion aux premiers pas de l’Opus Dei en Espagne : « Que les membres de l’Obra soient des laïcs, ne portant sur eux aucun signe religieux (…) est alors tellement original et subversif que l’Opus Dei va exciter pour longtemps les imaginations, aiguiser les controverses et les oppositions (…) L’Opus Dei touche en Espagne des ingénieurs, des médecins, des professeurs, des fonctionnaires, etc. Et c’est un autre procès de “conspiration” qui surgit : l’Obra cherche à infiltrer les milieux intellectuels, politiques, économiques, à “noyauter” tous les cercles d’affaires et de pouvoir. Ajoutons l’obstination qu’a mise José Maria Escriva à ses débuts pour faire reconnaître son œuvre par le Vatican de Pie XII (1939-1958), et tous les ingrédients du “mystère” sont réunis : l’Opus Dei est une société secrète et élitiste, soumise au Vatican, haut lieu de toutes les intrigues et richesses. Depuis le XVIe siècle, les jésuites sont poursuivis par cette même légende noire (…). L’Œuvre passe aussi pour très riche (…) Son pouvoir n’aurait plus de limite. Les “opusiens” auraient infiltré l’appareil d’Etat en Espagne, l’armée, les banques, l’industrie, la presse. Ils auraient manipulé le pape qui ne leur ménage aucune faveur, pris le pouvoir au sommet de la hiérarchie catholique. Dans la perspective du conclave qui élira le successeur de Jean Paul II, la presse vaticaniste compte déjà les cardinaux qui lui sont le plus favorables. »
Pour Henri Tincq, « la réalité est plus décevante. Les hommes et femmes engagés dans l’Opus le sont par libre consentement. Jamais les associations anti-sectes n’ont réussi à la faire figurer dans leurs “listes noires” (…) Dans la politique, l’Œuvre traîne comme un péché historique la participation de sept hauts fonctionnaires, membres déclarés de l’Opus Dei, dans des gouvernements franquistes de 1957 à 1972. Mais pour le reste, que d’excès! C’est faire beaucoup d’honneur à ses services de communication que de les confondre avec des agences d’infiltration des médias rappelant la période soviétique. Cette légende noire, c’est l’Opus Dei elle-même qui l’a créée, par la liberté laissée à ses membres. Tout membre en effet est libre de sa participation à un mouvement politique ou à une association. »
Henri Tincq conclut que la réponse aux questions que l’on peut se poser sur l’Opus Dei « n’est ni dans la culture du secret ni dans la propagation d’erreurs, qui, même répétées cent fois, n’ont jamais fait une vérité ».