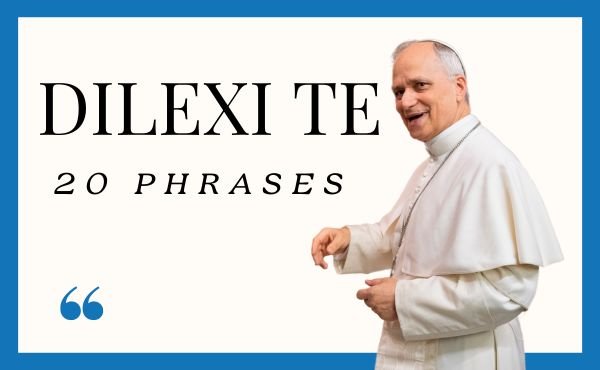1. Les petits gestes. Aucun geste d’affection, même le plus petit, ne sera oublié, surtout s’il est adressé à ceux qui sont dans la souffrance, dans la solitude [ou] dans le besoin. (DT 4)
2. A l’horizon de la Révélation. Nous ne sommes pas dans le domaine de la bienfaisance, mais dans celui de la Révélation : le contact avec ceux qui n’ont ni pouvoir ni grandeur est une manière fondamentale de rencontrer le Seigneur de l’histoire. (DT 5)
3. Le cœur de Dieu. C’est pourquoi, en écoutant le cri du pauvre, nous sommes appelés à nous identifier au cœur de Dieu qui est attentif aux besoins de ses enfants, en particulier les plus démunis. (DT 8)
4. De nombreuses formes de pauvreté. Il existe en effet de nombreuses formes de pauvreté : celle de ceux qui n’ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins matériels, la pauvreté de ceux qui sont socialement marginalisés et n’ont pas les moyens d’exprimer leur dignité et leurs potentialités, la pauvreté morale et spirituelle, la pauvreté culturelle, celle de ceux qui se trouvent dans une situation de faiblesse ou de fragilité personnelle ou sociale, la pauvreté de ceux qui n’ont pas de droits, pas de place, pas de liberté. (DT 9)
5. Transformation culturelle. L’engagement concret en faveur des pauvres doit également s’accompagner d’un changement de mentalité susceptible de se répercuter au niveau culturel. En effet, l’illusion d’un bonheur qui découlerait d’une vie aisée pousse nombre de personnes à avoir une vision de l’existence axée sur l’accumulation de richesses et la réussite sociale à tout prix, y compris au détriment des autres et en profitant d’idéaux sociaux et de systèmes politico-économiques injustes qui favorisent les plus forts. (DT 11)
6. Mentalité évangélique. Le fait que l’exercice de la charité soit méprisé ou ridiculisé, comme s’il s’agissait d’une obsession de quelques-uns et non du cœur brûlant de la mission ecclésiale me fait penser qu’il faut toujours relire l’Évangile pour ne pas risquer de le remplacer par la mentalité mondaine. (DT 15)
7. Une option radicale pour les plus faibles. Cette “préférence” (pour les pauvres) n’indique pas une exclusion ou une discrimination envers d’autres groupes, qui seraient impossibles en Dieu. Elle entend souligner l’action de Dieu qui est pris de compassion pour la pauvreté et la faiblesse de l’humanité tout entière et qui, voulant relever et inaugurer un Règne de justice, de fraternité et de solidarité, a particulièrement à cœur ceux qui sont discriminés et opprimés, demandant à nous aussi, son Église, un choix décisif et radical en faveur des plus faibles. (DT 16)
8. Reflet de la charité divine. Même dans les cas où la relation avec Dieu n’est pas explicite, le Seigneur lui-même nous enseigne que tout acte d’amour envers le prochain est en quelque sorte un reflet de la charité divine : « En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). (DT 26)
9. La générosité, un bien pour qui la pratique. À ceux d’entre nous qui sont peu enclins aux gestes gratuits et n’y portent aucun intérêt, la Parole de Dieu indique que la générosité envers les pauvres est un véritable bien pour ceux qui l’exercent : en agissant ainsi, nous sommes aimés de Dieu d’une manière particulière. (DT 33)
10. Accès privilégié à Dieu. Dès les premiers siècles, les Pères de l’Église ont reconnu dans les pauvres un moyen privilégié d’accéder à Dieu, une manière particulière de le rencontrer. La charité envers les nécessiteux était comprise non seulement comme une vertu morale, mais aussi comme une expression concrète de la foi dans le Verbe incarné. (DT 39)
À découvrir aussi : eBook "Dilexi te" : Exhortation apostolique sur l'amour des pauvres
11. Proximité avec les malades. La présence chrétienne auprès des malades révèle que le salut n’est pas une idée abstraite, mais une action concrète. (DT 52)
12. Le travail de l’homme. Dans l’encyclique Laborem exercens, [Jean Paul II] affirme que « le travail humain est une clé, et probablement la clé essentielle, de toute la question sociale ». DT 87)
13. La force de la charité. La charité est une force qui change la réalité, une authentique puissance historique de changement. C’est à cette source que doit puiser tout engagement visant à « résoudre les causes structurelles de la pauvreté »[1] et à le mettre en œuvre de toute urgence. (DT 91)
14. Un témoignage efficace. Le souci de la pureté de la foi ne va pas sans le souci d’apporter, par une vie théologale intégrale, la réponse d’un témoignage efficace de service du prochain, et tout particulièrement du pauvre et de l’opprimé.[2] (DT 98)
15. Se laisser évangéliser par les pauvres. Dans cette perspective, il apparaît clairement qu’« il est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser »[3] par les pauvres, et que nous reconnaissions tous « la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux »[4]. Ayant grandi dans une extrême précarité, apprenant à survivre dans les conditions les plus défavorables, faisant confiance à Dieu avec la certitude que personne d’autre ne les prend au sérieux, s’aidant mutuellement dans les moments les plus sombres, les pauvres ont appris beaucoup de choses qu’ils gardent dans le mystère de leur cœur. Ceux d’entre nous qui n’ont pas connu les expériences similaires d’une vie vécue à la limite ont certainement beaucoup à recevoir de cette source de sagesse qu’est l’expérience des pauvres. (DT 102)
16. Chemin de renouveau ecclésial. Tout renouveau ecclésial a toujours eu parmi ses priorités cette attention préférentielle envers les pauvres, une attention qui se distingue, aussi bien dans ses motivations que dans son style, de l’activité de n’importe quelle autre organisation humanitaire. (DT 103)
17. Maîtres silencieux d’humilité. Il n’est pas rare que le bien-être nous rende aveugles, au point de penser que notre bonheur ne peut se réaliser que si nous parvenons à nous passer des autres. En cela, les pauvres peuvent être pour nous comme des maîtres silencieux, ramenant notre orgueil et notre arrogance à une juste humilité. (DT 108)
18. Un cœur solidaire. Le cœur de l’Église, de par sa nature même, est solidaire avec ceux qui sont pauvres, exclus et marginalisés, ceux qui sont considérés comme des “rebuts” de la société. Les pauvres sont au centre même de l’Église, car c’est de « notre foi au Christ qui s’est fait pauvre, et toujours proche des pauvres et des exclus, [que] découle la préoccupation pour le développement intégral des plus abandonnés de la société »[5]. Il y a au cœur de chacun des fidèles « l’exigence d’écouter ce cri [qui] vient de l’œuvre libératrice de la grâce elle-même en chacun de nous ; il ne s’agit donc pas d’une mission réservée seulement à quelques-uns »[6]. (DT 111)
19. Le manque d’attention spirituelle. Nous ne parlons pas seulement de l’assistance et du nécessaire combat pour la justice. Les croyants doivent rendre compte d’une autre forme d’incohérence à l’égard des pauvres. En vérité, « la pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d’attention spirituelle […]. L’option préférentielle pour les pauvres doit se traduire principalement par une attention religieuse préférentielle et prioritaire »[7]. (DT 114)
20. L’aumône comme rencontre. Il convient de dire un dernier mot sur l’aumône, qui n’a pas bonne réputation aujourd’hui, souvent même parmi les croyants. Non seulement elle est rarement pratiquée, mais elle est parfois même méprisée. Je répète d’une part que l’aide la plus importante à une personne pauvre consiste à l’aider à trouver un bon travail, afin qu’elle puisse gagner sa vie de manière plus conforme à sa dignité en développant ses capacités et en offrant ses efforts personnels. Le fait est que « le manque de travail c’est beaucoup plus que le manque d’une source de revenus pour vivre. Le travail c’est aussi cela, mais il représente beaucoup, beaucoup plus. En travaillant, nous devenons davantage des personnes, notre humanité fleurit, les jeunes ne deviennent adultes qu’en travaillant[8]. […] D’autre part, si cette possibilité concrète n’existe pas encore, nous ne devons pas courir le risque de laisser une personne abandonnée à son sort, sans ce qui est indispensable pour vivre dignement. Et donc, l’aumône reste, entre-temps, un moment nécessaire de contact, de rencontre et d’identification à la condition d’autrui. (DT 115)
[1] Pape François, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 202.
[2] Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction sur certains aspects de la « Théologie de la libération », XI, 18.
[3] Pape François, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 199.
[4] Ibid., 198.
[5] Ibid., 186.
[6] Ibid., 188.
[7] Ibid., 200.
[8] Pape François, Discours à l’occasion de la rencontre avec le monde du travail à l’usine ILVA de Gênes (27 mai 2017).