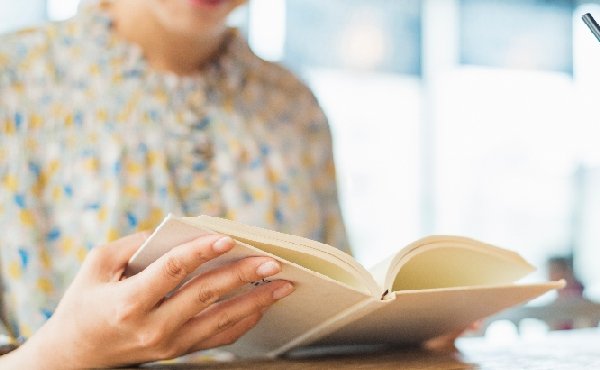Au cours des siècles, les institutions de l'Église ont diffusé leur message de diverses manières dans le monde où elles vivaient. En tenant compte de la mentalité de son époque et du caractère central de l'activité des laïcs dans l'esprit de l'Opus Dei, saint Josémaria a pensé à diverses façons, qui ont évolué au fil du temps, d’encourager les personnes de l'Œuvre à réaliser des initiatives d'empreinte chrétienne dans la société civile. Il a également considéré différents modes possibles pour l’appui économique et juridique de ces activités. Dans un premier temps, il a trouvé comme modèles existants celui des « académies »[1] universitaires à vocation professionnelle et chrétienne, comme l'Academia Cicuéndez où il enseignait le droit, ou les académies pour étudiants de saint Pedro Poveda. Au cours de ces premières années, il décida de donner une personnalité civile et non ecclésiastique à ces activités parce que cela correspondait mieux à l'esprit séculier de l'Œuvre qui met l'accent sur le rôle prépondérant des laïcs et leur capacité à créer des projets dans la société civile avec un esprit chrétien, et parce qu'il avait lui-même été témoin de la confiscation des biens ecclésiastiques au cours de la Seconde République espagnole. Dans les lignes qui suivent, nous résumons l'histoire de ces entités dans l’étape de fondation de l'Opus Dei.
Action personnelle et collective
Le fondateur de l'Opus Dei voyait l'Œuvre comme une grande catéchèse, réalisée principalement par des fidèles laïcs au milieu du monde. Dès les années de fondation, il a réfléchi aux moyens pratiques de transmettre la foi chrétienne et l'esprit de l'Œuvre. Dès 1930, il indiquait qu'il y aurait des formes individuelles et collectives à cet effet.
Le trait le plus caractéristique du charisme de l'Opus Dei était ce qui touchait à l’individu : c'est-à-dire que chacun des membres diffuse le message chrétien à travers ses relations, dans sa profession, sa famille et son entourage. D'autre part, Josémaria Escriva considérait que l'institution pouvait aussi promouvoir des activités ayant un impact positif sur la société : institutions dans lesquelles ses membres, sous leur propre responsabilité, feraient connaître l'esprit de sainteté dans la sphère séculière (par exemple, une résidence universitaire, un institut de recherche ou une maison d'édition). Ces actions seraient variées, puisque le message de l'Opus Dei est ouvert à tous les domaines humains, sans se limiter à des apostolats sectoriels spécifiques.
En ce qui concerne l'organisation d'activités collectives, les dirigeants de l'Opus Dei pouvaient proposer à certains de ses membres d'organiser des entités civiles dans la vie académique, professionnelle et culturelle, dans des domaines tels que l'éducation, la santé, la presse et le spectacle. Il s'agissait, en quelque sorte, d'une première tentative pour encourager les membres de l'Œuvre à exercer un apostolat séculier et civil.
L'académie et la résidence DYA (1934-1936) fut la première activité collective de ce type. Saint Josémaria voulut que les directeurs en fussent des laïcs professionnels et non lui-même. Plus tard, dans les années 40, d'autres résidences d'étudiants et d'autres centres de formation virent le jour.
Les œuvres collectives, les œuvres communes et les sociétés auxiliaires dans les années 1950
Une fois que l'Opus Dei reçut en 1950 l'approbation institutionnelle universelle du Saint-Siège en tant qu'institut séculier (l'Œuvre travaillait alors dans 9 pays), le fondateur formalisa dans des documents de gouvernement les modes apostoliques qui lui seraient propres : l'apostolat personnel et l'apostolat collectif. En ce qui concerne l'apostolat collectif, il établit deux catégories : les œuvres d'apostolat collectif et les œuvres communes.
Les œuvres collectives (œuvres d'apostolat collectif) ont été et sont des initiatives collectives dans le domaine de la formation intégrale, de l'éducation et de l'assistance. En d'autres termes, il s'agit de projets ayant une claire dimension évangélisatrice et non lucrative. Ces initiatives naissent en réponse à des besoins sociaux, soit sous l'impulsion directe de l'Opus Dei, soit en accueillant des initiatives existantes. Dans tous les cas, les directeurs de l'Œuvre cherchaient activement, en union avec les promoteurs de ces activités, à favoriser cette dimension évangélisatrice des œuvres collectives et à conseiller sur les aspects de viabilité économique.
Le nom d'œuvres communes, en revanche, a été donné à des initiatives entrepreneuriales promues par des membres de l'Opus Dei et liées à la diffusion de valeurs chrétiennes par le biais de publications et de moyens de communication et de divertissement. Dans ces œuvres – tant qu’elles ont duré –, les dirigeants de l'Opus Dei assumaient un rôle de conseil doctrinal et d'orientation apostolique. Les œuvres communes faisaient partie de ce que le fondateur appelait « l'apostolat de l'opinion publique ».
Les sociétés auxiliaires étaient des entités créées par des membres de l'Opus Dei avec la coopération d'autres personnes pour agir en tant que propriétaires de biens civils qu'ils louaient ou transféraient à d'autres entités pour mener des activités éducatives, caritatives et culturelles. Comme dans toute entité, les membres acquéraient des parts de capital ou apportaient de l'argent. Les sociétés auxiliaires allaient de l'organisme propriétaire de résidences universitaires à d'autres qui soutenaient des activités telles qu'une revue culturelle ou une chaîne de librairies. Bien qu'il s'agisse juridiquement de sociétés commerciales, le fondateur les appelait sociétés auxiliaires parce que leur but premier n'était pas commercial, mais de fournir un soutien matériel à une activité apostolique.
Tant dans les œuvres de l'apostolat collectif que dans les œuvres communes, l'Opus Dei veillait à ce que l'orientation des contenus et de l'enseignement soit conforme à la doctrine catholique. Dans les premières années, les directeurs de l'Œuvre nommaient les responsables de ces initiatives. Pour leur part, les responsables assumaient la responsabilité juridique et financière et rendaient compte aux autorités de l'Opus Dei de l'avancement des projets.
Outre les résidences universitaires, les deux premières œuvres d'apostolat collectif dans le domaine de l'éducation furent l'école Gaztelueta (Bilbao, 1951) et l'Estudio General de Navarra (Pampelune, 1952) qui deviendra l'Université de Navarre en 1960. En 1954, une école de sport appelée Brafa vit le jour à Barcelone. Elle s'occupe de la formation des jeunes et de la promotion des valeurs à travers le sport. Les initiatives éducatives postérieures virent le jour à Culiacán (Mexique) en 1955, avec l'école et le lycée de Chapultepec. Les deux centres éducatifs développèrent une section complémentaire de formation professionnelle.
De leur côté, à partir de 1952, plusieurs œuvres communes dans le domaine de la communication virent le jour. Dix ans plus tard, les membres de l'Œuvre avaient donné vie à des initiatives de ce type dans sept pays : des revues culturelles et universitaires, trois quotidiens, deux revues professionnelles, un hebdomadaire graphique, une revue de théologie pratique, une revue de cinéma et une revue populaire. Mais également un réseau de librairies en Espagne, quelques maisons d'édition, des agences de communication, des ateliers d'art sacré et plusieurs forums culturels.
Dans ces entités, les directeurs de l'Œuvre étaient chargés de veiller à la dimension évangélisatrice et de conseiller sur la viabilité des projets. À cette fin, dans cette période de l'histoire, le président de l'Opus Dei ratifiait la nomination du directeur de chaque œuvre commune et nommait un conseiller spirituel. En revanche, les instances dirigeantes de l'Opus Dei ne dirigeaient pas les conseils d'administration ou les comités éditoriaux et ne donnaient pas non plus d'instructions sur leur contenu informatif.
L'apostolat collectif dans les années 1960
Dans les années 1960, trois changements ont modifié la présence collective de l'apostolat de l'Opus Dei dans la société : l'ouverture d'un plus grand nombre d'universités, de collèges et d'écoles techniques ; l'apparition de ce que l'on a appelé les œuvres personnelles ; et la fin des œuvres communes d’apostolat.
Le fondateur avait suggéré aux membres de l'Opus Dei de créer des œuvres collectives qui seraient des universités ou des centres d'études supérieures dans un plus grand nombre de pays. En même temps, il leur rappelait que se consacrer collectivement à l’enseignement privé n'était pas une fin en soi pour l'Œuvre. Mais, d’un autre côté, la sécularisation rendait opportun d'élargir les espaces académiques, en montrant la compatibilité de l'Évangile avec les domaines de la connaissance. Ces œuvres devaient chercher à offrir un modèle de travail professionnel compétent et de vie chrétienne ouverte aux personnes de toutes confessions.
La deuxième université créée en tant qu'œuvre d'apostolat collectif vit le jour à Piura (Pérou) en 1969 et présente dès le départ une forte composante de promotion sociale. Dans d'autres pays, des initiatives visant à devenir de futures universités virent le jour, comme l'Instituto Femenino de Estudios Superiores (Guatemala City, 1964) ou le Center for Research and Communication (Manille, 1967). En ce qui concerne l'enseignement primaire et secondaire, la priorité fut donnée à l'ouverture d'écoles dans les quartiers ouvriers ou industriels de diverses villes du monde. La formation professionnelle et technique, réglementée ou non, reçut également une impulsion particulière, non seulement à travers les écoles qui s'inscrivaient dans cette ligne, mais aussi à travers des initiatives telles que les centres de formation professionnelle, les écoles rurales familiales, les écoles de secrétariat, d'hôtellerie, les écoles de langues, les écoles ménagères et les écoles culturelles. Dans la perspective de l'Opus Dei, ces espaces éducatifs étaient conçus comme un moyen adéquat pour contribuer à l'augmentation du niveau de vie et à la diffusion du message chrétien.
La naissance des œuvres personnelles
En 1963, un groupe de membres surnuméraires en Espagne s’adressa aux autorités de l'Opus Dei pour ouvrir encore plus de centres éducatifs. Saint Josémaria dit qu'il ne voyait pas la possibilité de créer un réseau d'écoles qui seraient des œuvres d'apostolat collectif parce que le service que l'Opus Dei s'engageait à fournir dans ce type de projet nécessiterait la disponibilité de nombreuses personnes de l'Œuvre et qu'il y avait un risque que l'enseignement absorbe l'activité institutionnelle. Mais, si les parents promouvaient de nouvelles écoles, l'Opus Dei leur offrirait la collaboration d'aumôniers, de professeurs de religion formés et d'un accompagnement spirituel. Il ajouta, comme il l'avait déjà suggéré pour les œuvres d'apostolat collectif, que dans ces écoles – qui, à partir de 1966, ont été appelées œuvres personnelles – la priorité devait être donnée à la relation avec les familles et les enseignants afin de créer un contexte éducatif adéquat.
Quelques membres de l'Œuvre créèrent la société Fomento de Centros de Enseñanza (promotion de centres d’enseignement), puis d'autres sociétés éducatives furent créées, si bien qu'au milieu des années 60, il y avait plus de trente écoles qui étaient des œuvres personnelles en Espagne. Des initiatives similaires virent le jour dans la plupart des pays où les membres de l'Opus Dei étaient présents, en particulier en Amérique latine.
La fin des œuvres communes d’apostolat (1966)
Au fil des années, le fondateur s'était rendu compte que les œuvres dites communes présentaient de sérieux inconvénients. Le concept même de commun donnait lieu à une tension irrésolue entre l'indépendance professionnelle des responsables des projets et l'action des directeurs et directrices de l'Œuvre.
D'une part, les œuvres communes constituaient un ensemble d'initiatives professionnelles réalisées par des membres de l'Œuvre qui les dirigeaient ou y travaillaient à titre personnel ; chacune avait sa propre équipe de direction et était financièrement responsable devant la société financière qui la soutenait. Mais par ailleurs les autorités de l'Opus Dei maintenaient une tutelle spéciale afin de garantir la finalité évangélisatrice des projets et leur durabilité. Cette participation était basée sur la confiance, sans accords écrits.
D’autre part, il y avait une difficulté culturelle liée à la libre action des catholiques dans la société. Les médias créés et gérés par les membres de l'Opus Dei étaient non confessionnels et les entités qui les possédaient étaient des sociétés civiles. En raison de la structure de fonctionnement de ces entités et de la mentalité de l'époque, il était très difficile de distinguer et de comprendre la différence entre l'activité personnelle de certains membres et l'action institutionnelle des dirigeants de l'Opus Dei. Si un membre de l'Œuvre dirigeait un média, on en concluait que l'institution était responsable en dernier ressort de la ligne éditoriale de cette publication, en particulier sur les questions polémiques et politiques. Et si les dirigeants de l'Opus Dei le niaient, ils étaient accusés de secret, de contrôler les médias dans l'ombre.
En plus de ces difficultés, certains membres de l'Œuvre firent appel aux directeurs régionaux avec des critiques ou des points de vue non partagés par un média dirigé par un autre membre de l'Opus Dei.
En somme, après quinze ans de fonctionnement, les œuvres communes rendaient difficile la compréhension du message de l'Opus Dei sur la liberté individuelle et le pluralisme légitime des catholiques dans la vie publique et les choix professionnels. Compte tenu de l'évolution de ces premières années, il n'était pas cohérent qu'il y ait des médias qui, encouragés par les directeurs de l'Œuvre, soient perçus comme des expressions institutionnelles dans des domaines où la diversité des opinions était légitime et revendiquée par l'esprit de l'Œuvre. Après une période de réflexion, en décembre 1966, le Fondateur annonce la fin de ce type d’œuvres. Dès lors les initiatives apostoliques collectives se répartiraient entre les œuvres d'apostolat collectif et les œuvres personnelles dans les domaines de la formation, de l'éducation et de la santé.
Dans les années suivantes, une fois effectif leur désengagement de l'Œuvre, certaines des initiatives à caractère culturel ou de communication qui étaient nées comme œuvres communes poursuivirent leur activité entrepreneuriale à titre personnel, et d'autres mirent fin à leurs activités. L'idée de promouvoir la participation des laïcs à des initiatives ayant un impact public chrétien est restée très présente et a été clairement encouragée par les autorités de l'Œuvre, mais dans des cadres juridico-institutionnels différents qui ont évolué au fil du temps pour mieux distinguer les domaines de responsabilité et d'action. Dans ce processus, les autorités de l'Opus Dei ont mieux défini leurs compétences à l'égard de ces initiatives : encouragement à les promouvoir, formation à la doctrine sociale pour leurs promoteurs, responsabilité individuelle pour y investir financièrement, etc.
Dans l'évolution de la forme de ce type d'instrument, une meilleure prise de conscience par le fondateur des exigences de la sécularité et de l'apostolat des laïcs, qui impliquait de façon plus évidente la libre prise en charge des responsabilités personnelles – comme l'avait souligné le Concile Vatican II qui venait de s'achever – a également joué un rôle. C'est ce qu'il dira quelques années plus tard dans une célèbre homélie[2].
Disparition des sociétés auxiliaires (1969)
Josémaria Escriva comprenait que la démarche des sociétés dites auxiliaires était conforme à l'esprit séculier de l'Œuvre et promouvait la responsabilité des laïcs dans l'évangélisation. L'Opus Dei, en tant qu'institution, ne possédait pas de biens, ni civils ni ecclésiastiques ; par exemple, il ne possédait pas de biens immobiliers et ne recevait pas de legs, sauf dans des cas exceptionnels. N'étant pas des entités ecclésiastiques, les sociétés n'engageaient pas l'Église ou l'Opus Dei dans les transactions financières et professionnelles.
Pour donner une finalité apostolique aux sociétés auxiliaires, les dirigeants de l'Œuvre désignaient un conseiller technique chargé de veiller à ce que la société remplisse sa finalité directe ou, généralement, indirecte d'évangélisation ; il n'était pas nécessaire qu'il occupe un poste de gouvernement dans l'entité, mais il disposait d'un siège au conseil d'administration ou au conseil de surveillance pour faciliter son intervention. En outre, au moins 51% du capital de l'entité était entre les mains de personnes qui partageaient la volonté d'irradiation chrétienne de l'activité, afin d'assurer le maintien de la finalité.
Dans les années 1950, certaines entités se développèrent de manière significative, en particulier en Espagne. Le cas le plus significatif de société auxiliaire est ESFINA (Sociedad Española Anónima de Estudios Financieros, 1956), un groupe de fonds d'investissement qui détenait la majorité des actions de diverses entités (œuvres communes) à vocation essentiellement apostolique. ESFINA détenait la majorité des actions de la maison d'édition SARPE (Sociedad Anónima de Revistas, Periódicos y Ediciones), créée cinq ans plus tôt pour détenir des actions dans des entités dédiées aux moyens de communication. Le groupe ESFINA était également membre du conseil d'administration d'autres sociétés, telles que la maison d’éditions DELSA et les distributeurs de films Dipenfa et Filmayer, entre autres.
Lors du congrès général extraordinaire de l'Opus Dei, en septembre 1969, les participants firent le constat que de nombreuses personnes pensaient que l'institution dirigeait des entreprises économiques. Il n'était pas facile d'expliquer que les biens et les projets appartenaient aux personnes ou aux entités qui les avaient promus. Après avoir étudié cette difficulté, le fondateur décida également de supprimer les sociétés auxiliaires, pour qu'il soit clair que les instruments matériels utilisés dans les activités apostoliques appartenaient à leurs propriétaires et que l'Œuvre n'administrait pas ces sociétés.
Les tentatives de création et de consolidation d'une structure de soutien à certaines initiatives à finalité évangélisatrice – certaines ayant échoué, d'autres non – permettent de conclure que le critère de réussite de ces œuvres n'était pas seulement économique ou même pas l’efficacité évangélisatrice, mais aussi le fait qu'elles exprimaient clairement ou non l'esprit de sécularité de l'Œuvre, dont le fondateur avait précisé les manifestations concrètes au fil des années et de l'expérience qu'il avait accumulée. En effet, au moment de la disparition des œuvres communes, certaines d'entre elles étaient économiquement viables.
Ces changements successifs au cours de la vie du fondateur ont contribué à façonner l'apostolat collectif de l'Opus Dei. Compte tenu de la variété des initiatives et des cultures ou législations nationales, il a parfois fallu quelques années pour gérer les inerties naturelles et façonner les relations de l'actuelle Prélature de l'Opus Dei avec toutes les entités éducatives et sociales qui, aux termes d'un accord entre les deux parties, reçoivent de l'Opus Dei une orientation formative et un soin pastoral, selon les nos 121 à 123 de ses statuts actuels.
Pour une vision plus développée et documentée de cette évolution, il est conseillé de lire : " Historia del Opus Dei " (José Luis González Gullón et John F. Coverdale, Ed. Rialp, Madrid 2021, pp. 235-255 et 318-343).
[1] NdT. Terme qui désignait en Espagne des instituts privés, sans lien avec les universités publiques, qui offraient une préparation complémentaire à l’obtention de diplômes officiels.
[2] « Vous devez diffuser partout une véritable mentalité laïque, qui conduit aux trois conclusions suivantes : être suffisamment honnête pour assumer sa responsabilité personnelle être suffisamment chrétien pour respecter les frères dans la foi qui proposent, dans les matières de libre opinion, des solutions différentes de celles que défend chacun d’entre nous ; être suffisamment catholique pour ne pas se servir de notre Mère l’Église en la mêlant à des factions humaines. (...) Prenez donc mes paroles pour ce qu’elles sont : une exhortation à exercer vos droits, tous les jours, et pas seulement dans les situations difficiles ; à vous acquitter noblement de vos obligations de citoyens – dans la vie politique, dans la vie économique, dans la vie universitaire, dans la vie professionnelle – en assumant hardiment toutes les conséquences de vos décisions libres, en endossant vos actes avec l’indépendance personnelle qui est la vôtre » (Entretiens, Homélie Aimer le monde passionnément, no 117).