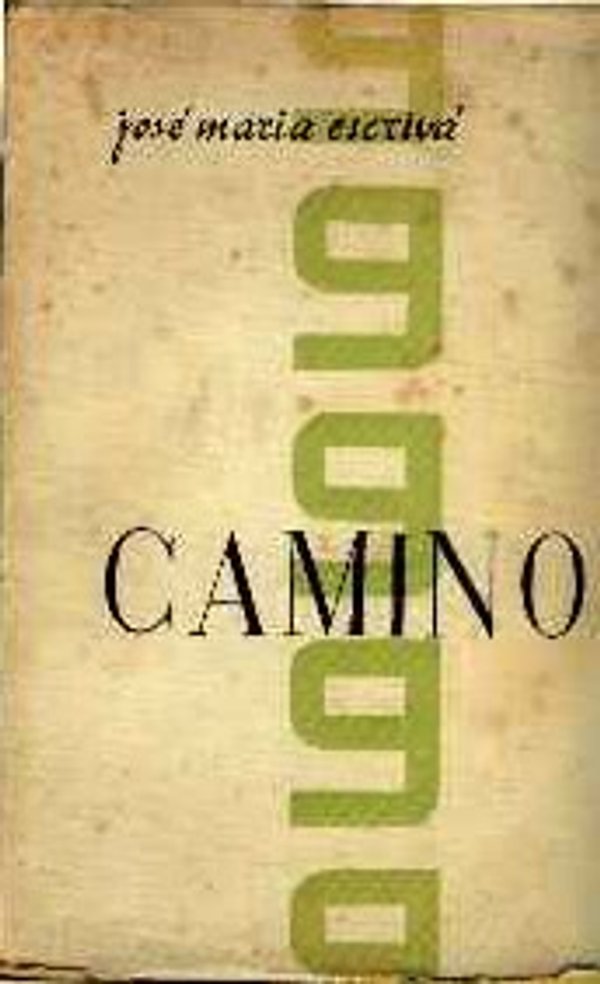L’histoire de la rédaction de Chemin a une date symblique : “décembre 1932”. L’auteur l’avait inscrite sur un petit fascicule, au format d’un quart de feuille paysagé, qui est la première ébauche de ce futur livre. Ce recueil de feuillets est le germe “publique” de Chemin.
Vous pouvez lire le résumé d’une conférence de mgr Pedro Rodríguez. Le texte intégral a été publié dans le 7ème volume des "Cuadernos del Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer"
l. Les « Cahiers intimes » et la rédaction de « Chemin »
Que personne ne s’étonne de voir que j’entre dans le vif de mon sujet de façon si documentaire. Je peux vous communiquer que les archives concernant Chemin et son processus de rédaction sont particulièrement abondantes. On pourrait dire, dans un certain sens, que l’information est exceptionnelle, si l’on considère aussi d’autres œuvres de l’auteur. Et cependant, je dois avouer tout de suite qu’il est difficile de trouver un auteur, autre que Josémaria Escriva, ayant le moins parlé du livre qu’il prépare. On ne trouve guère de documents où il parle de ce projet, de ses idées concernant le futur du livre, de son sujet.
Ce que je dis peut être surprenant, surtout si l’on considère que, durant toute la période de rédaction, saint Josémaria tenait des Cahiers de notes personnelles, qui ne sont pas un journal au sens classique, recueillaient de nombreuses nouvelles de sa vie quotidienne : spirituelle, intellectuelle, familiale, pastorale et apostolique. Ceci dit, à la seule lecture de ces Cahiers, on ne pourrait pas déduire que leur auteur avait projeté, préparé et écrit, le livre qui est l’objet de cette conférence.
Mais je dois avouer en même temps que, paradoxalement ! c’est dans ces Cahiers que l’on trouve la matrice, mieux encore, le contenu textuel du livre qui sera finalement publié en 1934 sous le titre Considérations spirituelles, qui est, comme vous le savez bien, la première phase imprimée de Chemin2.
1.1 Les Cahiers des « Notes intimes »
Disons quelques mots de ces Cahiers, une source de première importance, pour l’édition critique de Chemin.
Au nombre de neuf, ils vont de l’année 1928, voire un peu avant, aux premières années quarante. Nous n’en avons que huit aujourd’hui. Le Cahier n° 1 fut détruit par l’auteur et nous en ignorons le contenu. Il n’est donc pas compris dans les Notes intimes3.
À la base des Notes intimes, il y a toujours cette vie plongée en Dieu. Il prenait des notes n’importe où, fréquemment dans la rue. L’interaction entre le « feuillet » qui recueillait ses notes et le Cahier sur lequel il les transcrivait reflète le soin extrême que saint Josémaria portait aux motions de Dieu dans sa vie. Ce va-et-vient des notes au Cahier est une manifestation de sa foi en la présence et en la providence de Dieu : une foi qui le conduisait à la lecture surnaturelle des événements, petits ou grands, de son âme et du monde.
a) Nous pouvons distinguer quatre types de notes dans ces Notes intimes : Un premier groupe, constitué par les textes qui concernent de façon directe l’esprit, la mission et l’organisation de l’Opus Dei. Ils ont parfois la forme d’une réflexion, d’autres, le style du dialogue avec le Seigneur — dans ce sens ils ressemblent à ceux du second groupe—, d’autres, une expression presque juridique ou normative.
b) Le second groupe correspond à ce que nous appellerions aujourd’hui une autobiographie spirituelle : ce sont des expériences intimes de son amitié avec Dieu et avec les hommes : dans l’Eucharistie, l’oraison, le travail, l’action sacerdotale et apostolique, dans les contradictions et dans la pauvreté, dans la façon quotidienne d’exprimer sa piété filiale. L’humilité de saint Josémaria est réellement impressionnante.
c) Le troisième groupe de notes est plus dans la ligne d’un Journal. Il s’agit de l’activité quotidienne ou de plusieurs jours : des visites, des travaux, des démarches, l’étude, la prédication, les charges de famille, son action pastorale par monts et par vaux, ses projets apostoliques, ses randonnées à Madrid, d’un endroit à un autre. Une autobiographie, comme dans le groupe précédant, mais plus narrative, toujours considérée dans la perspective de Dieu, de l’action de Dieu en son âme et dans les âmes de ceux qui l’entourent et sous un angle thématique
d) Le quatrième et dernier groupe est spécialement intéressant pour notre conférence : ce sont des textes qui n’ont pas le style narratif du groupe précédant, ni la forme autobiographique du second. Ce sont des pièces autonomes, qui viennent s’ajouter aux notes des deux groupes précédents : au point de vue littéraire, ce sont des aphorismes, des maximes, des « considérations » sur la vie en Christ, sur l’union à Dieu au beau milieu des circonstances ordinaires de la vie chrétienne. Sous un point de vue littéraire elles ont en commun avec celles du premier groupe, le caractère achevé et « autonome » de chaque note. Le climat des notes du second groupe est comme le foyer, le creuset, où ses « considérations » du quatrième groupe se forgent. Une fois frappées, elles viennent s’ajouter, se juxtaposent, se placent dans la séquence biographique des second et troisième groupes. À mon sens, cette façon d’écrire dans ses Cahiers donne une fraîcheur et une authenticité surprenantes à la séquence du texte ?
En 1932-33, alors que Chemin se forgeait, les Cahiers des Notes intimes débordaient déjà d’une doctrine spirituelle et d’une expérience des âmes qui ne demandaient qu’à être communiquées à d’autres. En les examinant sous les quatre angles du fond littéraire que j’ai indiqués, on voit comment les textes, que saint Josémaria peut sélectionner pour les faire connaître à un cercle plus large, ne font qu’augmenter. L’histoire de la rédaction de Chemin découle, grandement, de cette richesse spirituelle : d’abord l’édition, tirée sur vélographe, des Considérations spirituelles en deux carnets, puis, l’opuscule du même titre ; finalement, l’ouvrage qui nous occupe4.
Cependant, il faut bien préciser: le fondateur de l’Opus Dei n’écrit pas sur ses Cahiers pour en tirer un livre, mais — comme il le disait déjà en février 1931— parce que « je me sens poussé à conserver, non seulement les inspirations de Dieu — des inspirations divines, je le crois fermement — mais des choses de la vie qui m’ont été utiles ou dont je peux tirer un profit spirituel et qui peuvent aider mon père confesseur à mieux me connaître5 ».
J’ai déjà avancé que c’est de ce patrimoine qu’est totalement issu le contenu de Considérations spirituelles : principalement de ce quatrième groupe de textes mais aussi des autres, spécialement de ceux du second groupe et du troisième. Notre auteur le disait quelques années plus tard : « Chemin est issu, en partie d’une espèce de journal, — non, non, ce n’est pas un journal, les journaux m’assomment — écrit en l’honneur de Sainte Catherine. Chacune de ses notes rappelle un événement ou concerne quelqu’un. J’ai classé ces fiches en 1933 et je les ai remises à l’imprimerie en 1934.6 »
Le climat de Chemin, comme auparavant celui de Considérations spirituelles, est celui des Notes intimes de saint Josémaria.
C’est l’impression vécue qu’ont eue nombre de ceux l’ayant connu dans les premières années trente et ayant perdu son contact dans le tourbillon de la vie. Lorsqu’ils ont lu Chemin, ils ont eu devant leurs yeux, ce modeste carnet polycopié qu’il leur avait distribué vers la fin de 1932 et qui, comme je l’ai dit au début, est la première expression publique du futur Chemin.
1.2 La rédaction de « Chemin »
Venons-en maintenant à cette liasse de feuillets. 17 feuillets dactylographiés, format paysagé, tapés sur une mauvaise machine à écrire — et par un ou par une dactylo très maladroits — et polycopiés au vélographe. Le carnet a 246 considérations numérotées7 . Son titre est : CONSEILS SPIRITUELS/ CONSIDÉRATIONS SPIRITUELLES8 . Date : décembre 1932. Sur le dernier quart de feuille, tout blanc et sans numéroter, cette note finale : DEO OMNIS GLORIA. Le nom de l’auteur ne se trouve nulle part : le fascicule est anonyme.
Au début de l’été de 1933, Escriva remettait au vélographe un nouveau fascicule, un second bloc de considérations. Plus bref que le précédant. Il s’agit de sept feuillets, aux mêmes caractéristiques. Le premier avec une entête : « CONSEILS SPIRITUELS/ CONSIDÉRATIONS SPIRITUELLES (suite) ». Il y a 87 nouveaux textes dont la numérotation suit celle du fascicule précédant : l’auteur s’était arrêté au numéro 333. Ce fascicule était inconnu jusqu’à aujourd’hui dans la littérature biographique. Je l’ai trouvé dans les documents de l’AGP. Cette petite trouvaille m’a permis d’établir que l’édition vélographiée a 333 points, un tiers du futur Chemin. Ceci nous permet de dire que Josémaria avait voulu exprimer les considérations de son ouvrage en code « trinitaire » dès 1933.
L’année suivante, le contenu des fascicules, auxquels s’ajoutent 110 autres considérations tirées des Notes intimes, sont allés chez l’imprimeur : il s’agit de l’édition de Cuenca, sous format 15 x 10,5 cm. Sur la page de garde précédente qui était aussi la page de titre, on lit : « CONSIDÉRATIONS SPIRITUELLES / par / José María/ Cuenca.-Imp. Moderna/. »
L’auteur, nous pouvons le constater, est toujours anonyme. En 1939, apparaît l’édition définitive intitulée : Chemin. C’est celle que nous connaissons, avec ses 999 points. L’édition princeps paraît à Valencia en septembre de la même année, sous grand format, avec 336 pages et avec le dessin géométrique fameux qui traverse de haut en bas les deux pages de garde. L’auteur avait préparé le texte pendant la guerre civile espagnole, d’abord dans son refuge de la Légation du Honduras (Madrid, 1937) puis à Burgos, tout au long de 1938. On conserve une collection de presque 550 quarts de feuille autographes avec lesquelles il a complété, jusqu’au numéro 999, les points publiés dans l’édition de Cuenca. Il a fini de dactylographier, personnellement, le livre au petit matin du 2 février 1939. On conserve aussi cet original dactylographié. Ce sont des pièces d’une valeur extraordinaire.
Pourquoi Josémaria tient-il à publier ces fascicules, puis à les prolonger dans Considérations spirituelles et en Chemin. Que cherche-t-il, qu’est-ce qui le pousse à écrire et à éditer cet ouvrage, devenu désormais un classique dans la littérature chrétienne ? Voici ma réponse : nous ne sommes pas devant la volonté d’un « auteur » qui veut publier un « livre » mais devant la responsabilité d’un prêtre qui se sait porteur d’une mission et d’un message et qui tient à toucher un nombre croissant d’âmes. Il essaie de les convoquer à la mission qu’il a reçue le 2 octobre 1928 et de leur donner la formation spirituelle appropriée. Il voit alors que la parole orale ne suffit pas et se sent pressé de la prolonger dans l’écrit. Cette finalité claire et simple est, à mon avis, celle qui va déterminer la genèse aussi bien historique que théologique de cet ouvrage célèbre. Voyons-là de près.
2. La finalité et les destinataires de « Chemin »
Avant de se décider à préparer les fascicules cités, saint Josémaria prêtait ses feuillets à d’autres qui se trouvaient ainsi devant des « horizons insoupçonnés » (point 973), ou bien il réunissait ses jeunes amis et leur lisait des pages spirituelles — au dire de ces témoins — « d’un Cahier qu’il portait avec lui9 ». Mais son rayonnement spirituel et apostolique grandissant, ce n’était plus ni suffisant, ni possible. Ces textes-là, par ailleurs, n’étaient pas faits pour une lecture occasionnelle : il fallait les ruminer dans l’âme et les méditer devant le Seigneur. Il était dépassé par l’événement. Il a donc décidé de tirer de ces Cahiers les passages qui lui ont paru les plus adéquats, de les polycopier et de les distribuer. Il s’agissait d’intensifier la formation « à distance » de ceux qui recevaient de cet auteur leur direction spirituelle10.
Petit à petit, il fit parvenir ces « conseils », — notre auteur qualifiait lui-même ainsi ses fascicules —, aux personnes, prêtres et laïcs, hommes et femmes, les plus impliqués dans son projet spirituel et apostolique. Lorsque l’année précédente, l’Auteur s’était proposé de diffuser, aussi des polycopiés, la première ébauche du Saint Rosaire, il avait expliqué clairement à son confesseur le but de ces notes : « Je vous remets ces feuillets afin que vous me disiez, s’il vous plaît, si vous voyez un inconvénient à ce qu’ils soient tirés au vélographe, afin d’encourager nos amis à entreprendre la voie de la contemplation.11 »
Nous n’avons pas de déclaration équivalente pour ce qui concerne les fascicules. Cependant, en les lisant, on déduit que la finalité est semblable, pour ne pas dire la même, que celle de Saint Rosaire (comme l’auteur finira par l’avouer dans le prologue de Chemin). En lisant et en méditant aussi ces feuillets velographiés on s’imprégnait de l’esprit contemplatif que l’auteur diffusait dans son travail apostolique.
Ces textes polycopiés lui permettaient de toucher plus de gens, c’est vrai. Mais ce n’était pas le quantitatif, mais le qualitatif qui poussait Josémaria Escriva. Ces feuillets étaient pour lui l’instrument pour avancer et approfondir la formation de ceux qu’il avait déjà touchés ou qu’il était en train de toucher : nos amis, comme il dit familièrement. Autrement dit : avec cette initiative, il voulait pousser vers la plénitude de la vie chrétienne ceux qui étaient déjà en contact avec « le projet » qu’il leur proposait.
Cette finalité et ces destinataires sont présents lorsqu’il décide de passer de la polycopie à l’imprimerie. Nous trouvons dans Considérations spirituelles et tout autour d’elles, des déclarations intéressantes de l’auteur à ce propos. C’est dans « l’avertissement préliminaire » au début du livre, que nous trouvons la première. Il cerne concrètement les amis dont il parle : « des jeunes laïcs étudiants dirigés par l’auteur ». Le livre est écrit « pour répondre à leurs besoins ». Ensuite, déjà dans le prologue, il dit simplement au lecteur, dans une prose poétique, que ces pages sont des propos de prêtre, « une confidence d’ami, de frère, de père », pour être méditées en la présence de Dieu qui les écoute. Saint Josémaria continue donc de « pousser » vers la vie d’oraison.
C’est dans le prologue de Chemin qu’il recueille et prolonge ce qu’il écrivait en celui de Considération spirituelles. La intentio de l’auteur est presque formulée comme celle de Saint Rosaire, mais de façon personnelle et extrêmement belle. Le livre est écrit, dit-il, pour que : « tu entreprennes des chemins d’oraison et d’Amour ».
Contrairement à ce qu’il fait dans Considérations spirituelles, dans Chemin, il ne parle absolument pas des destinataires. Je crois en comprendre la raison : ce qui est né pour un cercle d’amis, pour les jeunes étudiants de l’Académie DYA et ceux du foyer de la rue Ferraz — tâches apostoliques naissantes de l’Opus Dei à l’époque —, est maintenant offert par l’auteur, dans une édition commerciale, à tout type de lecteurs. Mais le livre, littéralement le même, avec de nouvelles considérations ajoutées, ne perdra, à aucun moment, la touche juvénile de son auteur et des ses lecteurs d’origine.
Pour résumer : en écrivant successivement les fascicules, Considérations spirituelles, Chemin, l’auteur a voulu offrir aux lecteurs du livre, dont le premier destinataire était la jeunesse universitaire, un instrument pour « entreprendre des chemins d’oraison et d’Amour ». Le terme du chemin est décrit dans ce prologue de façon inhabituelle. C’est la première fois qu’on le retrouve ainsi, il s’agit de devenir: « une âme au discernement sûr », « arriver à être une âme au discernement sûr ».
Notre recherche sur l’intentio ou finalité du livre doit maintenant se pencher sur un texte, écrit longtemps après, qui est la déclaration la plus achevée et la plus mûre de l’auteur de Chemin sur son « objectif » au moment de l’écrire. Saint Josémaria parle de ce que tout fidèle de l’Opus Dei tient à chercher la sainteté dans l’état de vie où Dieu l’a appelé. Ceci devient possible, dit-il, grâce à « l’unité de vie », « où s’unissent la contemplation et l’action, et où le travail sanctifié et sanctifiant est comme le gond sur lequel pivote toute notre activité, interne et externe12 ».
Le travail, dit-il encore, devenu moyen de sanctification personnelle et d’apostolat, est tissé sur la pratique des vertus chrétiennes, grâce aux différentes manifestations de dévotion — « à la Très Sainte Trinité, au Christ dans l’Eucharistie, à la Sainte Vierge »— qui sont la trame de la vie spirituelle. C’est ici que l’on touche à notre sujet : « J’ai écrit une bonne partie de Chemin entre 1928 et 1933, publié en 1934. Avec cette publication j’ai essayé de préparer un plan incliné très long, pour que les âmes puissent petit à petit le gravir et arrivent à saisir l’appel divin, en devenant des âmes contemplatives au beau milieu de la rue.13 »
Nous avons là, vingt ans après, ensemble et bien expliqués, les éléments de l’intentio de l’Auteur que nous avons petit à petit trouvés dans des documents écrits simultanément au livre : contemplation, oraison, action, travail, vie intérieure et qu’il résume en cette nouvelle formule : arriver à être « des âmes contemplatives au beau milieu de la rue 14 ».
Cependant, notez bien qu’avant d’en arriver là, l’Auteur nous dit que le bout de ce plan incliné est tout simplement « comprendre l’appel divin » (à cette unité de vie, à cette sanctification du travail, à cette vie ordinaire vécue dans ce siècle), et c’est de cette compréhension vitale que jaillit l’oraison contemplative aux carrefours du quotidien.
Vous voyez donc que l’Auteur, en formulant l’intentio de son livre, vient de faire une importante déclaration —la seule jusqu’à présent— sur la structure « interne » du livre. Prenons-en bonne note. Son ordo est déjà conçu :
a) comme l’ascension sur un plan incliné qui atteindra la « contemplation » dont il parle,
b) comme la compréhension, qui signifie pour lui un don total à la vocation ainsi comprise,
c) en tant que vocation qui conduit à la contemplation au beau milieu du monde.
L’histoire de la rédaction montre comment ce livre déborde le petit cercle des proches (les fascicules) et atteint la jeunesse universitaire de Madrid (les Considérations de Cuenca) ainsi que la généralité des lecteurs (texte définitif : Chemin) sans avoir été à peine modifié15. L’Auteur a ainsi pu dire, un an avant sa mort, lors d’une rencontre avec des fidèles de l’Opus Dei : « Je l’ai écrit pour toutes les âmes… non pas pour nous.16 »
Il en avait parlé dans ce sens, quelques années auparavant, à un journaliste français : « Il ne s’agit pas d’un ouvrage pour les membres de l’Opus Dei seulement, mais pour tous, même pour les non chrétiens17. »
Cette affirmation mérite d’être retenue. Au fil du temps, il l’a fréquemment répétée et il l’a écrite de sa main dans la note à la 26ème édition de Chemin (1965). « C’est écrit, dit-il, à partir de l’expérience déjà très longue des gens de toutes les races, de tant de langues et de mentalités différentes. Il parle de « millions d’âmes qui se sont approchées davantage de Dieu Notre Seigneur », qu’il qualifie « d’amis très chers » et qui sont « des catholiques et des non catholiques, des chrétiens et des non chrétiens18 ». L’Auteur voit ainsi que les lecteurs du livre dépassent tout type de frontières.
Par ailleurs, comme l’Auteur le dit à un autre endroit, « il est évident que [ce livre] est imprégné de l’esprit de l’Opus Dei19 » et qu’il suppose, dans sa logique interne, la catéchèse de la foi catholique qui en déborde ainsi qu’une expérience consciente de la vie sacramentelle de l’Église. En 1934, il avait expliqué à don Francisco Moran, vicaire général du diocèse de Madrid, que Chemin n’est utile que pour quelqu’un qui veut avoir une vie intérieure20. C’est une grande vérité qui, autrement exprimée, a été reprise trente après pour le journaliste français Guillemé-Brûlon : « Chemin doit être abordé avec un minimum d’esprit surnaturel, de vie intérieure et de souci apostolique. 21 » On pourrait déjà en déduire deux choses : d’abord que ces préalables ecclésiaux peuvent bien se trouver, dans un certains sens, d’après l’expérience de l’Auteur, au-delà des frontières visibles de l’Église catholique 22; puis qu’un livre si profondément intra chrétien montre qu’il a une capacité paradoxale à devenir un instrument dans l’annonce ad extra de l’Évangile. Il me semble que cette expansion gigantesque et insoupçonnée du cercle des lecteurs de Chemin a lieu sans que soit altéré ce que le Pr.Garrido Gallardo a cru vérifier : à savoir qu’une lecture authentique du livre ne peut être faite que par quelqu’un « qui jouisse de ce que saint Jean de la Croix appelait « la simplicité de l’esprit 23», et qui soit prêt à accueillir les paroles comme une « confidence d’ami, de frère, de père » 24.
3. La structure théologique de « Chemin »
3.1. Le sens de la structure pour comprendre « Chemin »
La structure « organique » de tout ouvrage, toujours importante pour sa compréhension, l’est ici à plus juste titre. Nous avons déjà cité « l’Avis préliminaire » de Considérations spirituelles où l’Auteur montre combien il est pris par le sujet25, et combien cette entreprise est difficile. Cette difficulté réside, très souvent, d’après ce qu’il en dit, dans le fait que beaucoup, sans doute la plupart, des considérations pourraient être placées à plusieurs endroits dans le livre, à d’autres chapitres ou à de différents paragraphes du chapitre affecté. […]
Le sujet est important parce que la structure donnée à ces contenus d’origine particulière, personnelle et intime, la façon de les enchaîner et de les communiquer au lecteur est précisément ce que l’Auteur a mis dans son ouvrage, en tant que livre, étant donné que Chemin, — Considérations spirituelles surtout —, est un ouvrage qui, quant à son fond littéraire et à son contenu, n’a jamais été rédigé « comme un livre ». […]
Le travail de Josémaria Escriva dans la rédaction du Chemin à Burgos est parfaitement documenté et nous permet, malgré le silence de l’Auteur sur la structure de l’ouvrage, d’induire sa méthode de travail et de connaître beaucoup de choses sur la structure et l’ordre grâce auxquels il bâtit petit à petit son ouvrage. Le résultat de notre recherche sur ce thème est une proposition d’intelligence interne de la structure du livre, de sa séquence théologique et spirituelle. Je tiens donc à vous en présenter les lignes fondamentales.
L’étude de cette série continue des 46 pièces majeures qui composent le livre, en cherchant leur enchâssement théologique, spirituel et anthropologique, m’a permis de conclure que le livre est articulé en trois Parties, qui ont, chacune à son tour, comme deux sections ou divisions internes. Le schéma définitif en serait le suivant :
I. Première partie (ch. 1-21).
Suivre le Christ : les débuts du Chemin
A) Prière, expiation, examen (ch. 1-10)
B) Vie intérieure, travail, Amour (ch. 11-21)
II. Deuxième partie (ch. 22-35)
Vers la sainteté : marcher « in Ecclesia »
A) Église, Eucharistie, Communion des Saints (ch. 22-25)
B) Foi, vertus, lutte intérieure (ch. 26-35)
III. Troisième partie (ch. 36-46)
Pleinement en Christ : appel et mission
A) Volonté et Gloire de Dieu, enfance spirituelle (ch. 36-42
B) Vocation et mission apostolique (ch. 43-46)
Nous avons vu comment Chemin contient deux fois plus de matériel que Considérations spirituelles et que son ordo est le définitif du livre. Comment l’Auteur construit-il la structure des trois parties relevées ? Afin de ne faire qu’un seul livre des deux apports littéraires — celui de Considérations spirituelles et celui des feuillets de Burgos — l’Auteur s’est servi d’une méthode d’intégration dont nous n’allons pas parler maintenant et que j’ai évoquée dans l’Introduction générale de l’édition critique citée. Je voudrais simplement souligner que dans l’esprit de l’Auteur il ne s’agit pas d’écrire un nouvel ouvrage, mais d’amplifier celui qui existe déjà. […]
3.2. Articulation théologique et spirituelle de « Chemin »
La difficulté qu’il y a à « articuler » les chapitres de Chemin et à les insérer dans une systématique théologique est évidente26. Le plan académique des matières de théologie et les schémas des manuels échouent à l’heure de comprendre la séquence d’un ouvrage, qui, par ailleurs, est plein d’intuitions et de suggestions théologiques. Le schéma théologique de compréhension que j’ai proposé et que je vais commenter n’a pu faire surface qu’après avoir pris au sérieux ce qu’est le livre d’après son Auteur. D’où l’importance donnée à l’aspect de la captation de son intentio. Nous en avons beaucoup parlé. Je n’y reviendrai plus. Cette intentio nous fait voir que le plan, la dispositio, de Chemin n’est pas « systématique », mais clairement existentielle. Elle est issue des dons de Dieu et de l’expérience sacerdotale de l’Auteur : expérience d’un prêtre qui a une connaissance profonde de la personne humaine devant Dieu, — et concrètement, des jeunes étudiants, configurateurs immédiats du livre — ; d’un prêtre qui a « quelque chose » à dire aux personnes qu’il fréquente : un message de sainteté au milieu du monde. Ce « plan incliné » qui est son mot d’ordre en la matière, est prêt à partir de la réalité concrète de ce destinataire du livre qui est celui qui domine méthodologiquement Chemin et que l’Auteur aimerait conduire, sur des « chemins d’oraison et d’Amour » jusqu’à la pleine découverte de sa vocation à la sainteté et à l’apostolat.
En voici un exemple : la position presque initiale dans le livre (ch. 2) du thème « Direction ». Ne faudrait-il pas plutôt parler, en premier, d’autres graves réalités de l’économie de la grâce : la Foi, l’Église, la Vie surnaturelle, la Sainte Messe, la Charité, la Communion des saints, pour ne citer, avec ses propres titres, que quelques chapitres de Chemin ? Bien sûr que si, d’un point de vue « systématique », — systématique théologique, exposition « organique » — : la « direction spirituelle » dont parle l’Auteur n’a de place qu’après, dans tous ces systèmes. Et l’Auteur le sait parfaitement bien. Mais il est en train « d’ordonner » son matériel compte tenu de son intentio et du destinataire qu’il a dans son cœur, dans son esprit et dans sa réalité quotidienne. Il sait donc que pour que cette personne gravisse ce plan incliné et parcoure ce chemin, il faut lui parler, le plus vite possible, de « direction spirituelle » : du besoin d’un guide sur le chemin. Nous pourrions en dire tout autant du chapitre 4 : « Sainte pureté ». Pourquoi ne se trouve-t-il pas dans la deuxième partie du livre, avec les autres vertus ? C’est là qu’il serait à sa place dans ce système. C’est là où il se trouvait dans le fascicule de 1932… Il y a donc eu, comme ce fut déjà le cas en Considérations spirituelles, une décision formelle de placer le chapitre à sa place actuelle. C’est le même cas que tout à l’heure. L’Auteur sait que si l’on veut grimper et atteindre la pleine union à Dieu, la pureté est une marche de la première volée. De cette façon, ce livre « anti-systématique » est petit à petit configuré dans un profond sens théologique, anthropologique et spirituel. C’est dans cette perspective, de façon synthétique, comme je l’ai déjà dit, que nous allons considérer ces trois parties du livre :
a) Première partie : « Suivre le Christ »
Dans la première partie que j’ai intitulée « Suivre le Christ : les débuts du chemin », j’ai groupé les vingt-et-un premiers chapitres du livre. Pour comprendre Chemin, il est décisif de saisir le sens du premier chapitre que l’Auteur intitule « Caractère ». On se tromperait si on voyait dans ce chapitre une « introduction humaniste » au Christianisme ou à la vie spirituelle du chrétien. Beaucoup de ses aphorismes parlent, en effet, des traits essentiels de la personnalité humaine, mais l’Auteur situe son dialogue, dès le début, à l’intérieur de « l’économie de la grâce » ou, comme il le dit lui-même, dans « l’économie de l’esprit » (n° 234) : le point de départ est la présence du Christ chez le lecteur qui dialogue avec lui. Josémaria Escriva admet, nous l’avons déjà dit, que l’interlocuteur de Chemin a déjà une expérience de la vie sacramentelle et spirituelle. C’est précisément le sens théologique et pastoral des paroles du prologue : « Je ne vais rien te dire de nouveau. Je vais remuer dans tes souvenirs. »
Ainsi donc dès le premier numéro, il touche directement les implications existentielles de la condition chrétienne : « Que ta vie ne soit pas une vie stérile, sois utile, laisse ton empreinte. Que rayonne la lumière de ta foi et de ton amour.
Efface, par ta vie d’apôtre, la trace visqueuse et sale qu’ont laissée les impurs semeurs de haine. — Et embrase tous les chemins de la terre au feu du Christ que tu portes dans ton cœur. »
Cet emblématique numéro 1 est en effet décisif pour comprendre le « plan incliné » dont l’Auteur nous parle : un plan qui, méthodologiquement parlant, demande la réalité de la foi et du baptême et se projette, à partir de là, sur la vie humaine du chrétien qui doit être radicalement réformée — littéralement, à partir de la racine : à partir du Christ— pour atteindre les sommets de la sainteté et du don. S’il y a quelque chose qui donne son unité au livre, et dès le premier numéro, c’est bien son « christocentrisme » total : c’est avec le Christ qu’il faut gravir ce plan incliné, dans le Christ et à la suite du Christ. Ce critère thématique dès le premier chapitre est en réalité un critère herméneutique pour la lecture du livre dans toutes ses Parties, mais il l’est spécialement dans cette première. L’Auteur dialogue petit à petit avec les lecteurs, — pour mieux dire avec son lecteur, explicitement tutoyé, en Chemin — et leur parle des premiers pas à la suite du Christ et des coordonnées fondamentales de cette démarche. Dans la Section A, sans préambules, l’Auteur met le lecteur face à la nécessite de cette profonde « réforme » de sa vie personnelle — thème de fond du chapitre 1 — pour arriver ensuite à ce qu’on pourrait appeler « les conditions nécessaires» : la direction spirituelle, la vie de prière, la propreté du cœur, l’esprit de mortification et de pénitence, l’examen personnel. Ce sont les sujets des dix premiers chapitres du livre.
Les onze autres font partie de la Section B. Les chapitres 11-16 montrent comment travailler (étudier) sous le regard de Dieu ou comment chercher l’union avec Dieu dans le travail (étude) et orientent directement vers la suite du Christ au milieu du monde, dans la vie professionnelle et séculière. Les quatre chapitres suivants (ch. 17-20) parlent de la sainteté nécessaire à cette suite : la sainteté du chrétien est à situer sur « un plan paradoxal » (ch. 17) où il faut vivre l’Amour de Dieu (ch. 18) et des frères (ch. 19), en s’appuyant, pour tout, sur la Croix et sur l’Évangile (ch. 20). Et ce, sous le regard maternel de la Sainte Vierge Marie (ch. 21). […]
Cette Première partie de Chemin comprend presque la moitié du livre : 516 points. Dans un certain sens on peut dire que tout y est déjà dit. Cela accorde aux deux autres parties un sens singulier pour ce qui est du plan incliné. Considérons-les brièvement.
b) Deuxième partie : « Marcher in Ecclesia »
La deuxième partie de Chemin a 237 points et se trouve, dans le schéma proposé, sous le titre « Vers la sainteté : marcher « in Ecclesia ». […]. Cette Partie contemple et décrit, comme je l’ai déjà dit, la vie chrétienne comme une marche vers la sainteté dans l’Église et dans le cadre de sa tradition sacramentelle et spirituelle.
La Section A de cette deuxième partie est presque entièrement nouvelle27. Ces trois premiers chapitres sont une nouvelle création : « L’Église », « la Sainte Messe », « La Communion des Saints ». Ils sont le cadre de l’ecclésialité de la proposition spirituelle de l’Auteur qui confère son sens propre à l’ancien chapitre « Dévotions ». On pourrait décrire théologiquement ainsi cette séquence : l’Église Mère (ch. 22), le Christ et son Sacrifice vivant dans son Église (ch. 23), l’Église, communion et fraternité (ch. 24), la communion sur terre avec l’Église du Ciel (ch. 25 : « Dévotions »).
La Section B est le développement de la vie « eucharistique » et ecclésiale du chrétien28. L’Auteur s’arrête, tout d’abord, aux vertus chrétiennes, à commencer par la foi et l’humilité, les vertus « de base » de cette suite du Christ29. Puis, en un deuxième temps, il contemple le caractère militant et eschatologique de la vie « in Ecclesia », qui comporte souffrance, lutte, espérance : ce sont les chapitres « Tribulations », « Lutte intérieure » qui décrivent le combat dans la pratique des vertus, et « Fins dernières », pour clôturer cette deuxième partie.
Où est donc le sens singulier de cet ensemble de chapitres de Chemin dont j’ai parlé ? Je crois que cette deuxième Partie n’est pas, à proprement parler, le progrès sur ce plan incliné mais une reconsidération, une réaffirmation du « chemin » parcouru (première partie),qui est contemplé maintenant sous un angle ecclésial. C’est une façon de souligner que la vie du chrétien, décrite jusqu’à présent comme « vita in Christo », est inséparablement une vie « in ecclesia » : la vie à partir de la maternité de Marie et de l’Église, la vie à partir de l’Eucharistie et des sacrements, la vie qui est une communion des saints : avec les autres chrétiens ici, sur terre, avec l’Église triomphante au Ciel, une vie dont le sens est eschatologique. « Chemin », dit J. Morales, pense le Christianisme en tant qu’Église. 30 »
c) Troisième partie : « Pleinement en Christ »
La troisième partie est aussi longue que la deuxième : 246 points. L’Auteur, dès le premier fascicule, avait placé vers la fin du livre une série de « considérations » qui, dans ses cahiers de Notes intimes, contemplaient plus directement certains aspects de la vie, la fin, l’esprit, le travail et l’apostolat des fidèles de l’Opus Dei, naissant à l’époque. Par conséquent, c’est dans cette partie de Chemin que l’on trouve plus fréquemment ces retouches de la rédaction qui tiennent à ce que le livre soit pour tous les chrétiens.
Nous pouvons aussi détecter deux sections. Dans la section A l’Auteur ébauche, devant le chrétien parvenu à ce stade, un « profil » approfondi du don de soi à Dieu. Il le voit comme un homme ou une femme, radicalement engagé dans la Volonté et la Gloire de Dieu (ch. 36 et 37), cherchant des collègues et des amis qui partagent son idéal (ch. 38), sanctifiant son travail dans le soin des « petites choses » (ch. 39), chacun à sa place, sans « m’as-tu- vu » (ch.40), se sentant « petit », un enfant devant Dieu et confiant en Lui totalement (ch. 41-42). L’Auteur invite le lecteur à plonger dans cette voie, à se perdre dans l’Amour de Dieu jusqu’à devenir un « contemplatif au milieu de la rue » comme il est dit dans le texte témoin de notre discours.
Or, pour l’Auteur de Chemin, cette contemplation est totalement inséparable du souci des âmes, de l’engagement apostolique, de la mission. La section B qui termine le livre est en effet consacrée à renforcer l’universalité de l’appel personnel à la sainteté sous l’aspect inséparable de l’appel universel — personnel ! — à l’apostolat. C’est la mission, l’action apostolique qui est la clé de l’interprétation que Chemin donne à la vocation chrétienne, à la sainteté : la mission — conduire le monde à Dieu : « omnes cum Petro ad Iesum per Mariam » (n° 833) — qui attire le chrétien vers la sainteté. Cette section n’avait qu’un chapitre en Considérations spirituelles : « L’Apostolat », que l’Auteur a restructuré, à partir des matériaux de Burgos, pour faire les chapitres actuels 43-45 : « Appel », « L’apôtre », « L’apostolat ». Le livre s’achève en parlant de persévérance sur le chemin (ch. 46) pour arriver au sommet définitif du plan incliné : le Ciel.
Je voudrais souligner deux aspects dans cette troisième partie. Tout d’abord, le relief acquis par certaines dimensions de la vie chrétienne qui étaient déjà évoquées et agissantes dans les chapitres précédents mais qui deviennent maintenant extrêmement explicites. C’est la section A qui en donne l’exemple le plus clair. Dans les deux chapitres sur « enfance spirituelle » : un sujet qui configure Chemin dès le premier point31, mais qui est ici développé de façon étonnante. L’on peut dire la même chose, à plus forte raison, du chapitre « Volonté de Dieu », « Gloire de Dieu », etc. Ceci fait voir que pour l’Auteur, ces réalités ont un rapport direct et immédiat avec le but de ce chemin qui est, comme nous le savons bien, « comprendre » sa propre vocation, être « une âme contemplative au milieu de la rue ». Dans la section B de cette troisième partie qui achève le livre, il faut dire quelque chose de semblable pour ce qui est des chapitres consacrés à « l’apostolat ».
Mais ce que nous disons doit être surtout appliqué à « Petites choses » qui, en tant que chapitre, a été crée de toutes pièces à Burgos. L’Auteur l’articule en commençant par deux points (813 et 814) qu’il tire du chapitre « Charité » de Considérations spirituelles. Puis il y introduit cinq autres points (les 815-819 actuels) qu’il tire d’ « Enfance spirituelle » (où ils formaient déjà une séquence). À ces sept points de Cuenca, il ajoute onze de plus, rédigés à Burgos. Le soin, le souci des « petites choses » dans ce nouveau chapitre ne va plus apparaître comme l’expression directe du chemin d’enfance spirituelle (tel qu’il se trouve dans l’imprimé de Cuenca) mais comme la signification de l’amour de Dieu et du prochain dans la sanctification de l’activité ordinaire du chrétien32. C’est cela qui est important à mes yeux dans « l’autonomie » que le sujet acquiert dans sa rédaction de Burgos. L’Auteur qui avait entamé un vrai « chemin d’enfance » dans son amitié avec Dieu, tout en se sentant « enfant » devant le Seigneur, a vu toujours, en toute clarté, que ce chemin n’était pas forcément celui de tous. La « vie d’enfance spirituelle » peut être enseignée, mais non pas imposée parce qu’elle est un pur don de l’Esprit Saint33. Et, en même temps, avec cette même clarté, il voyait que « le soin des petites choses » n’est pas « optionnel » mais une dimension fondamentale, constitutive, de la sanctification du travail professionnel et de la vie ordinaire qu’il enseignait aux fidèles de l’Opus Dei et à celui qui voulait bien l’entendre34. […]
J’en arrive à ma deuxième considération : ce qui est nouveau dans cette Troisième Partie c’est la force des soulignés des valeurs et la radicalité des propositions. L’appel que Dieu t’a adressé à ton entrée dans l’Église, Dieu lui-même tient « maintenant » — dans l’histoire personnelle que « tu » vis en ce moment — à ce qu’il prenne des formes concrètes et à ce qu’il acquière des contenus déterminés, auxquels Dieu t’appelle : c’est la Volonté de Dieu pour la Gloire de Dieu. C’est dans cet appel de Dieu que la sainteté et l’apostolat fusionnent. C’est « l’atmosphère » de ces dernières étapes du plan incliné. On perçoit le but du chemin. Selon Chemin, ce n’est que dans la fidélité à la mission apostolique que l’on trouve la vie contemplative au milieu du monde.
Ces textes ont jailli au fil des dix premières années de l’Opus Dei et Chemin nous livre ainsi un témoignage théologique et spirituel de ce message et de cette vie. Un témoignage d’un grand prix pour comprendre l’aventure que saint Josémaria a vécue, dans laquelle il a entraîné un grand nombre des ici présents. Il l’a lui-même expliqué, à Sao Paulo, en parlant de Chemin ici même, en cette immense Amérique: « Je l’ai écrit pour toutes les âmes, non pas seulement pour nous ; mais il est évident qu’il est tout imprégné de l’esprit de l’Opus Dei. Rien n’y est étranger à l’Opus Dei, mais l’esprit de l’Opus Dei n’y est pas tout entier. 35 »
Au terme de ma conférence, il ne me reste qu’à vous remercier de m’avoir permis de vous donner de bonnes nouvelles de mes études sur Josémaria Escriva, à la veille solennelle de son Centenaire. Et ceci à Buenos Aires, au cœur de cette touchante terre argentine tant admirée et bien-aimée.
Notes
1. L’on peut trouver une information plus approfondie et documentée sur le sujet de cette conférence dans l’édition critique de Camino, particulièrement dans l’Introducción General au volume : Josemaría ESCRIVA DE BALAGUER, Camino, édition critique-historique de Pedro RODRIGUEZ, prologue de Xavier ECHEVARRIA, vol. l de la Série I de la « Colección de Obras Completas », Rialp, Madrid 2002, XXXVI + 1196 pages ; 2 ème édition corrigée, juin 2002. On trouve aussi une information sobre et réussie dans Cincuenta años de historia, de Josep Ignasi SARANYANA ; dans Estudios sobre « Camino » de José MORALES (dir.) chez Rialp, Madrid 1988, pages 59-65. Nous signalons aussi les titres des trois paragraphes de l’article : « Las fuentes de Camino », « Historia de la redacción », « Estructura del libro ».
2. Consideraciones Espirituales est pratiquement tiré de ces Cahiers, pièce fondamentale d’un ensemble d’écrits autographiques que l’Auteur avait rassemblés et préparés et qui ont été présentés à la Cause de Canonisation sous le titre de Notes Intimes.
3. Ces cahiers se trouvent à l’Archive Générale de la Prélature de l’Opus Dei (AGP), sec.A, liasse 47, dossier 5 (cahiers I à IV) et 6 (cahiers V à VIII en double). Le Cahier I allait jusqu’en mars 1930. « La raison qui l’a poussé à le détruire, dit don Alvaro del Portillo dans une Note Préliminaire aux Notes Intimes, fut qu’il y avait consigné beaucoup d’événements d’ordre surnaturel et beaucoup de grâces extraordinaires que le Seigneur lui avait accordés. Saint Josémaria « ne voulait pas que « en s’appuyant sur ces données extraordinaires nous le prenions pour un saint, alors que, disait-il, « je ne suis qu’un pécheur ».
4. Une donnée sur ce crescendo. Des 246 (247 en réalité) points que contient le premier fascicule, 6 sont tirés du Cahier II, 10 du III, 44 du IV, 112 du V, 8 de l’appendice I (les notes de sa retraite spirituelle à Ségovie) et 61 du Cahier VI, qui était celui qu’il était en train d’écrire et qu’il acheva en demandant d’en dactylographier le texte. Il y a 6 textes de Consideraciones espirituales que je ne suis pas arrivé à identifier. Tout porte à croire qu’ils proviennent des Notes Intimes (celles qu’il a brûlées).
5. Notes Intimes , n° 167, 23 février 1931.
6. Notes prises lors d’une réunion, à Rome, le 22 mars 1966 ; texte dans AGP, sec. A, liasse 51.
7. Exemplaires en AGP, sec. A, liasse 54, dossier l, exp. L.
8. À cette époque, l’Auteur fait fréquemment référence à ce fascicule (et du suivant) en l’appelant : Conseils.
9. « Le cahier sur lequel il avait commencé à écrire ses pensées n’avait pas de croix sur la couverture mais à l’intérieur, sur un angle de la première page. C’était une croix à quatre flèches pointant vers les quatre points cardinaux. Je ne connais pas de copie à ce cahier. Il était écrit de sa propre main. Il le portait avec lui. Quelques fois, à la terrasse d’une buvette de la Castellana, au carrefour de la rue Riscal, où nous nous retrouvions à la tombée du soir, il nous en lisait des pages entières, ou seulement deux ou trois pensées » (Pedro Rocamora, témoignage, Madrid 12 novembre 1977 ; AGP, sec. A, liasse 100-48, dossier 3, exp. 5) La Castellana est l’une des avenues les plus traditionnelles de Madrid. Pedro Rocamora Valls (1911-1993), madrilène d’origine, était devenu par la suite un brillant avocat, journaliste. Il fréquentait le fondateur de l’Opus Dei depuis 1928.
10. Dans les « Normes provisoires » vélographiées (1933) que saint Josémaria remettait à ceux qui s’approchaient de l’apostolat de l’Opus Dei, on cite, comme « une norme du plan de vie spirituel », « la lecture quotidienne d’un chapitre des Saints Évangiles et, si possible, d’un livre de spiritualité ». « Ce serait bon qu’ils lisent fréquemment les « Conseils ou Considérations spirituelles ». Texte dactylographié dans AGP, sec. A, liasse 49, dossier 5, exp. 2.
11. Note de Josémaria Escriva au Père Valentin Sanchez Ruiz, Madrid décembre 1931 ; écrite sur l’exemplaire autographe de Saint Rosaire qu’il envoya à son confesseur et que celui-ci lui rendit après. Elle se trouve dans AGP, sec. A, liasse 58, dossier 2, exp. 1. L’Auteur a écrit en italiques.
12. Lettre du 29 décembre 1947/ 14 février 1966, n° 92. Il s’agit d’un document doublement daté qui se trouve dans AGP, sec. A, liasse 53, dossier 2, exp. 7.
13. Ibidem.
14. Comme nous le constatons, l’Auteur reprend les propos de 1931 sur le but qu’il s’est fixé en écrivant Saint Rosaire : « encourager à suivre la voie de la contemplation », « au milieu de la rue » ,souligne-t-il, car dans l’esprit de saint Josémaria, la contemplation ou la vie d’oraison ( être des « âmes d’oraison ») est, toujours, une oraison dans la rue, au beau milieu du monde, en plein dans l’activité séculière et dans une profonde « unité de vie » avec elle. Ceci explique que, même à une date ultérieure à celle que nous avons citée, il puisse reprendre sa petite formule de 1931. En 1971, on lui a demandé : Quel est le message principal de Chemin ? et il a répondu, sans équivoques : « Encourager les âmes à faire oraison, ce qui revient à les conduire à parler avec Dieu, à avoir une vie intérieure » (Notes d’un colloque à Rome le 8 avril 1971 ; AGP, sec., liasse 51) Voilà ce qu’il en est fondamentalement et, si le lecteur est un fidèle laïc, la méditation du livre et son enseignement le conduiront à sanctifier de l’intérieur son travail et sa vie séculière.
15. Il s’agit, bien entendu, d’un ajout de nouveaux textes et d’une nouvelle configuration de l’ordo.
16. Notes prises lors d’une réunion, Såo Paulo, le 29 mai 1974 ; AGP, sec A, liasse 51.
17. Entretien accordé à Jacques Guillemé-Brûlon et publié dans Le Figaro (Paris), le 16 mai 1966 ; texte recueilli dans Entretiens, n° 36.
18. Il avait dit dans l’entretien cité : « Parmi les personnes qui l’ont spontanément traduit il y a des orthodoxes, des protestants et des non chrétiens. »
19. Notes prises lors d’une réunion, 29 mai 1974 ; AGP, sec. A, liasse 51. Voir infra note 37. Une étude sur l’esprit de l’Opus Dei ne saurait se limiter à l’étude de Chemin, c’est évident.
20. « [Ces Considérations spirituelles] ne visent que les âmes voulant vraiment 1) avoir une vie intérieure 2) et se démarquer dans leur profession, ce qui, au demeurant, est une obligation grave. » (Lettre de Josémaria Escriva à Francisco Moran, Madrid, 26 avril 1934 ; EF 340426-1 ; souligné de l’original.
21. Entretien cité en note 17 ; texte dans Entretiens, n° 36. En parlant de Chemin, l’Auteur dit aussi au journaliste : « Il ne s’agit pas d’un code pour l’homme d’action. »
22. Cf. Concile Vatican II, Const. Lumen Gentium, n° 8 ; Decr. Unitatis redintegratio, n° 3. Voir à ce propos les observations pointues de Alvaro DEL PORTILLO, Sens théologique et spirituel de « Chemin », dans Estudios sobre « Camino », cité en note l, pages 48 et suivantes.
23. Cantique spirituel, prologue, l. Vie et œuvres de saint Jean de la Croix, édition critique de Lucino del Ssmo. Sacramento, BAC 15, Madrid 131991, p. 603.
24. Miguel A.GARRIDO GALLARDO, Literatura espiritual española del siglo XX. Sobre la obra escrita de san José María Escrivá de Balaguer, dans Homenaje al Prof. José Fradejas Lebrero, Ed. UNED, vol II, Madrid 1993, pages 629-642, citation page 634. La citation de Chemin est tirée du prologue.
25. On peut y lire : « Il n’est pas facile de départager les notes contenues dans ces cahiers, écrits sans prétension littéraire aucune, sans aspirer à être publiés, et ne répondant qu’aux besoins de jeunes étudiants dirigés par l’auteur. Cependant, on a essayé d’ordonner ces notes, sans prétendre avec cela combler des lacunes et des omissions manifestes, ni retoucher le style familier et affectif, afin de rendre leur lecture plus profitable, bien qu’en général, dans chaque partie, vu le caractère même des points abordés, il s’agisse de différentes matières. »
26. J’ai fait une proposition théologique sur Chemin dans « Chemin » et la spiritualité de l’Opus Dei, dans « Teología Espiritual » 9 (1963) 212-245 ; on peut aussi lire Pedro RODRIGUEZ, Vocación, trabajo y contemplación, Pamplona, EUNSA (« Colección Teológica », 50), Pamplona 21987, pages 85-123. J’y cherchais une compréhension systématique du contenu théologique de Chemin, alors que je cherche ici la compréhension théologique de la structure que l’Auteur donne à son livre.
27. Il n’y avait que le dernier chapitre « Dévotions » dans Considérations spirituelles. Des 58 points de cette section A, seuls 13 viennent du livre de Cuenca, et parmi ceux-là, 9 sont déjà compris dans le chapitre « Dévotions »
28. Pas très tard après, l’Auteur formule sa doctrine spirituelle sur l’Eucharistie au moyen de l’expression « la Sainte Messe, centre et racine de la vie chrétienne ».
29. Thomas d’Aquin les qualifiait de « fondamentales » dans le sens du « fondement d’un édificie spirituel » : avant tout, la Foi, qui l’est, au premier chef, à strictement parler (cf. Somme Théologique, IIa-IIæ q. 4 a. l)
30. José MORALES, « Introducción » à Estudios sobre « Camino », cité en note l, page 36.
31. Le point n° 1, dans la rédaction originaire des Notes Intimes, n° 586, rédigé le 26 janvier 1932 commençait ainsi : « Enfant, que ta vie ne soit pas… »
32. Lorsqu’il préparait Chemin, il rassemblait petit à petit les fiches qu’il avait gardées dans une enveloppe sur laquelle il avait écrit : « Petites choses » et que l’on conserve (AGP, sec. A, liasse 50-4, dossier l, exp. 19). Il se peut que certaines aient été recueillies au chapitre de Chemin portant aussi cet intitulé.
33. C’est ce qu’il explique au point n° 852.
34. Voici ce qu’il dit dans une méditation prêchée lors d’une retraite spirituelle à Madrid en 1945 dont on n’a pas pu établir la date exacte, et dont nous possédons les notes prises à propos de « La valeur des petites choses » : « Nous, toi et moi, nous ne pouvons pas négliger les petites choses qui sont la trame de notre vie. Si nous sommes vraiment attachés à suivre le Christ, si nous cherchons sincèrement la sainteté moyennant la sanctification du travail ordinaire, nous ne pouvons faire autrement qu’être fidèles à l’infiniment petit » (AGP, sec.P, liasse 18, page 22).
35. Notes prises lors d’une réunion, São Paulo (Brésil), le 29 mai 1974 ; AGP, sec. A, liasse 51.